A revoir (photos)
L'aqueduc de Castries par Les Plantiers
Vous pouvez agrandir les photos en cliquant dessus
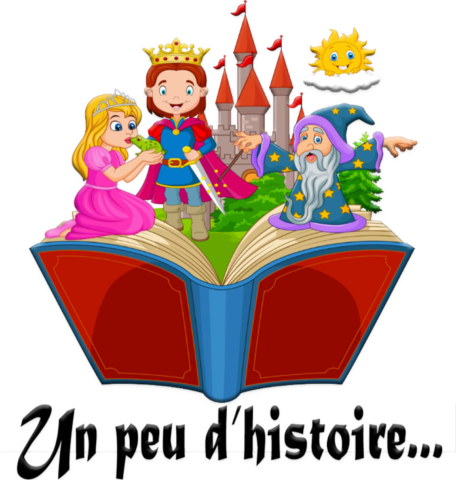
De par sa situation au sommet d'une colline, Castries a toujours été un lieu privilégié d'observation et de surveillance
Depuis de nombreux siècles, La présence d'un château a donné à ce territoire un rôle seigneurial et les maîtres des lieux, la famille De La Croix de Castries a, pendant plus de quatre siècles, contribué à la grandeur de la France, qu'ils aient été militaires ou ecclésiastiques, voire artistes
L'histoire mouvementée du château de Castries n'a pas empêché la famille de rester très attachée à son fief et de faire tout ce qu'elle pouvait pour le garder sous son contrôle, jusqu'en 2013 où la municipalité de Castries est devenue propriétaire de l'ensemble du patrimoine (château, parc, aqueduc, dépendances, mobilier)
Le château actuel a été bâti au 16ème siècle sur les restes d'un château médiéval, lui-même construit sur les ruines d'un castrum romain surplombant la Via Domitia
Au 17ème siècle, le château de Castries a bénéficié des talents de créateurs de grande renommée, en particulier André Le Nôtre, le jardinier du château de Versailles, qui en a dessiné le parc vers 1660
Mais aussi du concepteur du canal royal des deux mers (le futur canal du Midi), Pierre-Paul Riquet, qui élabora l'aqueduc vers 1670
Le chemin le plus efficace de l’eau n’étant pas le plus court, Pierre-Paul Riquet a imaginé un aqueduc de quasiment 7 kilomètres qui serpente en garrigue jusqu’au château, trois mètres d’altitude plus bas, soit une faible pente de 44 centimètres au kilomètre qu’il a fallu gérer sur les deux derniers kilomètres à l’aide d’un tracé plus aérien, porté par 157 arches
Une véritable prouesse...
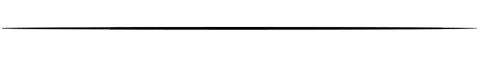

Un tiers de l'aqueduc de Castries est perché sur des arches s’élevant jusqu’à 20 mètres de haut, le reste est en tranchées, voire en tunnel, pour amener l'eau captée à la source de Fontgrand, une résurgence située sur la commune voisine de Guzargues
Notre balade nous emmène (entre autres) le long de la tranchée de l'aqueduc, jusqu'aux arches...
Notre chemin est bordé de balises "Passa Méridia", un itinéraire de 550 kilomètres de sentiers balisés qui part de Lunel, contourne le pic Saint-Loup par le nord, traverse Saint-Guilhem-le-Désert, se hisse sur le plateau du Larzac avant de se scinder en deux branches, l’une vers La Salvetat-sur-Agoût au nord et l’autre vers Caunes-Minervois au sud
60 mètres plus loin, nous arrivons à l'endroit où l'aqueduc, qui amène l'eau de la source de Fontgrand (Guzargues) au château, sort de terre
Construit en 1670 par l’architecte Paul Riquet, ce monument colossal de 6.822m de long servant à alimenter les jardins du château, est totalement enterré sur sa première partie, au ras du sol ensuite et enfin le sol se dérobe et il apparaît sur des arches dont certaines font plus de 20 mètres de hauteur, ce sera l'objet de la suite de notre balade
Nous remarquons des petits chênes kermès, signifiant "le chêne à cochenille donnant le rouge" car "Kermes vermilio" est le nom d'une espèce de cochenilles, des insectes parasites du chêne kermès
Dans la région de Montpellier, le parasite, de forme sphérique et se tenant immobile sur son hôte végétal, était récolté sur le chêne kermès afin de le dessécher puis de le broyer pour en tirer une teinture rouge écarlate
La récolte était d'environ 1 kilogramme de « graines d'écarlate » par matinée, permettant de produire 10 à 15 grammes de pigment pur
Les draperies de Montpellier étaient extrêmement réputées durant tout le Moyen Âge et habillaient les nobles même en dehors des frontières du royaume
Les femmes étaient nombreuses à œuvrer dans le secteur textile, elles travaillaient et brodaient les tissus destinés à la fabrication des tenues de la haute société, ces ouvrières portaient le griset, un vêtement de coton, de fil et de laine mêlés, de couleur grise, qui est à l'origine de leur surnom de "Grisettes de Montpellier"
320 mètres plus loin, nous apercevons un tout petit chemin à droite dans la végétation, nous l'empruntons, il mène à un joli abreuvoir en pierre
L'aqueduc avait suscité bien des jalousies des habitants, il fut donc décidé en 1734 que les castriotes auraient le droit de prélever de l'eau, mais avec modération
Une dérivation sur un abreuvoir a donc été créée dans le but d'alimenter en eau les troupeaux avoisinants
Lors de la révolution, le domaine fut confisqué et il fut question, en 1792, de démolir l'aqueduc, mais il finalement les révolutionnaires décidèrent de le préserver car il apportait de l'eau au peuple... Merci l'abreuvoir !
Nous sommes mi-janvier et nous découvrons avec surprise un très bel iris, annonciateur du printemps ?
Tout au long de notre balade, nous avons également côtoyé des cades, de la salsepareille et du lentisque pistachier
Il s’agit en fait d’une capelette, c’est-à-dire une petite chapelle, qui a une légende :
Dans le courant du 18ème siècle, un jeune couple avec son bébé a été pris en pleine garrigue et en pleine nuit noire dans la tourmente d'un orage d'une rare violence
Pris de peur, ils prièrent Dieu de les aider à trouver un abri et de les épargner de ce terrible orage
Au détour du chemin, une capitelle (un abri de berger) se présenta à eux et ils s’y abritèrent
Ils remercièrent Dieu et la Vierge Marie de les avoir protégés et jurèrent de revenir transformer cette capitelle en capelette
Les premières arches de l'aqueduc apparaissent à leur tour, il y en a précisément 105 jusqu'au château, distant d'environ 2 kilomètres de là, l'occasion de faire quelques photos (hivernales...)

Une très agréable balade familiale variée d'environ 7 kilomètres très sympa car très variée au niveau des paysages et d'un point de vue culturel
Lorsque nous avons proposé la sortie à "nos" adhérents de Lattes Loisirs Culture, nous avions au préalable pris rendez-vous avec le secrétaire de l'Association des Amis du Château de Castries (également -et entre autres- guide du château et participant au débroussaillage avec "les débroussailleurs de l’aqueduc"), qui a donné à tout le groupe (surpris car pas prévenu !) une montagne d'informations sur le patrimoine architectural et historique du château et de son aqueduc, nous le remercions vraiment très fort pour le temps qu'il nous a consacré et la richesse des informations qu'il nous a communiquées, nous vous invitons à visiter le site internet de l'association : https://www.amischateaudecastries.fr
Attention : cette balade que nous vous proposons est le résultat de nos reconnaissances, elle n'est pas (ou partiellement) balisée...
































































